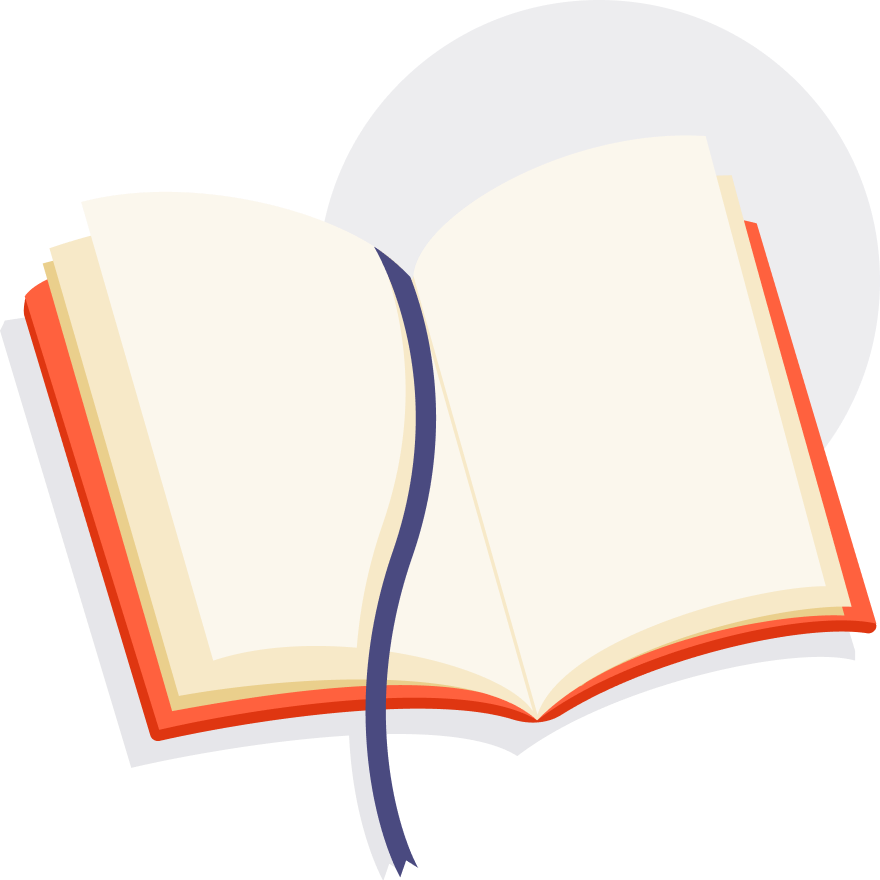A l’époque, un peu avant le Covid, je me gargarisais d’une histoire idéale : celle du travail comme levier d’émancipation à toute épreuve dans un monde où le mérite vaincrait tout obstacle. En réalité, ma vision était naïve. Au même moment, les revues RH étaient déjà parsemées de cet anglicisme apparemment neuf et qui traduisait un mal-être persistant au travail, jusqu’à l’effondrement : le burn-out.
Des corps cabossés, des esprits absents à eux-mêmes
Le terme burn-out ne date pas d’aujourd’hui. Il a été utilisé pour la première fois dans les années 1970 par le psychiatre américain Freudenberger qui le décrit en des termes précis et imagés, le comparant à un incendie qui consume les ressources internes de l’individu, alors qu’extérieurement rien ne se voit. Il écrira aussi un livre sur le burn-out et les femmes, particulièrement touchées. Nous en avions parlé dans une précédente newsletter ViveS.
Ce sujet m’attristait autant qu’il m’interrogeait. Je n’arrivais pas à comprendre comment le travail pouvait devenir un enfer. Je voyais des amies et amis tomber autour de moi, rester bloqués au lit pendant des jours entiers, anciens conquérants de projets formidables, ils ou elles s’étaient d’une certaine manière désagrégés. Et c’est à ce moment-là que la fiction s’est imposée. Je trouvais que c’était la meilleure manière de rendre hommage aux victimes et aux soignants autant que de susciter des prises de conscience. Il me manquait un élément : les témoignages de victimes de burn-out. Pendant près de neuf mois, je les ai recueillis un à un. Un tour de France itératif puisque je commençais par quelques amis qui tour à tour m’envoyaient vers une autre personne. Chaque entretien était saisissant. Il y avait des regrets et des larmes, des idéaux perdus et des déceptions amères. Il y avait des corps cabossés, des esprits absents à eux-mêmes, des émotions fugaces ou débordantes. Il y avait aussi des recommencements.
J’en ai retenu trois leçons importantes : d’abord que le burn-out est inarrêtable une fois déclaré et qu’il fait souvent suite à des mois de négligence de sa santé, de mauvais traitements au travail ou d’injonctions paradoxales qui nous grillent à petit feu.
Ensuite, que la surcharge de travail est un élément évident mais qu’il existe aussi d’autres clés qui accélèrent ou aggravent le phénomène. Le fait par exemple de se retrouver dans un système professionnel en opposition avec ses valeurs. Beaucoup de personnes m’ont raconté leurs attentes déçues dans l’enseignement, à l’hôpital ou encore le milieu associatif. Elles se sont sur-adaptées en permanence à des injonctions radicales de rentabilité, incompatibles avec les missions et les moyens des secteurs concernés. Enfin, le burn-out est un avertissement sévère qui peut conduire à des arrêts de travail de plusieurs années, voire permanents. Pour autant, il n’est pas forcément la fin de tout. Lorsqu’on a la chance d’être bien soigné, il pousse à revoir l’ordre de ses priorités. Il crée une brèche en vous qui laisse aussi entrer la lumière. Revenir du burn-out, c’est comme relancer votre vie, me disait Jean, ce serrurier très gravement atteint et tellement émouvant.
Cette nouvelle chance, Jean-Denis Budin la connaît bien pour l’avoir saisie au vol.
Une pédagogie innovante imaginée par un rescapé
Il a un débit précis et rapide, Jean-Denis. Quand on l’écoute, on est bien loin d’imaginer les extrémités qu’il a connues. Lui aussi raconte son histoire avec beaucoup de clarté. Il était cadre dirigeant et pilotait des activités entre plusieurs continents. La nuit dans les avions, le jour devant l’écran. Ou l’inverse. Peu de sommeil. Peu de temps de récupération. Vous savez ces “temps calmes” qu’on propose aux enfants au centre aéré pour leur permettre de déconnecter et de reprendre de l’élan. « Je passais ma vie entre plusieurs continents et je travaillais sans arrêt ou presque. J’y parvenais, donc cela me semblait tenable. Mais je n’avais eu aucune éducation à la question du sommeil par exemple, vitale pour faire face à une situation éprouvante », se souvient-il. À 45 ans, il s’écroule. Son système interne s’est déréglé. Les circuits ont lâché. Il a perdu la mémoire de longs mois. HS complet. Un burn-out qui a changé le cours de sa vie.
La bonne nouvelle, c’est que Jean-Denis Budin, bien entouré, a pu retrouver une énergie hors du commun malgré la gravité de son état : « Une vraie convalescence, avec une bonne hydratation, de l’exercice physique et beaucoup de convivialité, m’a permis non seulement de régénérer mon cerveau, mais également de développer de nouvelles capacités non maîtrisées auparavant, comme l’écriture de longs textes, et des aptitudes d’anticipation. J’ai vraiment la sensation d’avoir un cerveau différent par rapport à celui de la vie d’avant burn-out. »
De cette expérience traumatisante, Jean-Denis Budin a aussi tiré un projet inédit qui se déploie depuis une dizaine d’années : le CREDIR. Constitué d’une équipe experte de médecins, coachs, psychanalystes, entrepreneurs, le centre, basé en Alsace, accompagne des victimes de burn-out et intervient en entreprise avec des ateliers thématiques. Comme il nous l’explique, « par l’observation méthodique des situations de personnes qui ont flanché et par plus de 1000 heures d’entretiens déjà transcrits, nous sommes capables d’accompagner un individu dans son équilibre de vie global. Nous avons un institut de recherche interdisciplinaire pour nous appuyer sur des travaux scientifiques. »
La méthode du CREDIR s’articule autour de deux axes originaux. En premier lieu, la pratique du récit de vie : écouter les victimes raconter leur parcours sans les interrompre, en étant à leurs côtés dans ce moment de partage sans jugement. Ce recueil constitue à terme un corpus d’une grande justesse pour étudier des phénomènes psycho-sociaux et identifier des convergences ou au contraire des spécificités.
Le deuxième axe repose sur le concept de Qualité de Vie Globale (QVG), qui est composée de trois éléments : la santé, la Qualité de Vie au Travail (QVT) et la Qualité de Vie Hors Travail (QVHT). Cette approche globale est nécessaire. Car il est impensable d’imaginer qu’un job de rêve avec une situation personnelle calamiteuse soit à terme tenable et profitable à notre vie. De la même manière, ne pas dormir quand bien même nous aimons notre travail est forcément, à terme, délétère. Quelles que soient les chimères que l’on peut se raconter pour survivre dans le désordre de l’existence, notre cerveau et notre corps, eux, savent. Et tôt ou tard finiront par se rappeler à nous. On le voit bien dans les études récentes : en 2022, 1 salarié sur deux en France disait rencontrer une difficulté psychologique, selon le baromètre Harris Interactive sur le bien-être au travail, réalisé pour l’assureur Alan.
Innovant, le CREDIR fait partie de ces expériences humaines nées de l’épreuve, et qui rassemblent, comme nous l’explique Jean-Denis Budin : « Notre association fonctionne selon un système de don et de contre-don. Ce que j’ai vécu et ce qu’ont vécu ou connaissent mes collègues, nous essayons de le rendre utile aux autres. »
Pour aider à réparer et surtout prévenir, avant que la catastrophe ne se produise.
Trois pistes d’action pour développer le bien-être au travail
Quant aux entreprises et organisations, quels sont leur responsabilité et leviers d’action ? Selon le même baromètre Harris Interactive, 86% des salariés considèrent que l’entreprise est responsable de leur bien-être mental, et 85% déclarent que l’amélioration de leur bien-être mental augmenterait leur fidélité à leur employeur.
Dans certains cas, les entreprises prennent des “mesurettes” : ateliers de découverte sympathiques, babyfoots flambants neufs, salles de jeux qui feraient pâlir d’envie nos petits bouts de choux. Autant d’actions superficielles qui, sans être condamnables en soi, ne peuvent représenter une réponse suffisante à l’un des maux de notre siècle. S’ajoute ici un effet tabou à ne pas négliger, puisque seulement 7% des Français osent parler de leurs difficultés psychologiques à leurs supérieurs et responsables des ressources humaines.
Traiter les symptômes est souvent plus simple et plus rapide qu’en chercher les causes. Cela ne nécessite pas de questionner profondément ses pratiques et au fond, le projet de son organisation. On ne désamorce alors pas la charge allostatique, cette usure des corps qui doivent s’adapter sans cesse à des situations de stress ou de crise.
Pour anticiper les risques psycho-sociaux et concevoir des politiques internes solides afin de les réduire, trois pistes d’action me paraissent fondamentales :
1/ Traiter la question du sens. Mot-valise par excellence, parfois galvaudé, il est cependant intimement lié au bien-être. Les émotions positives au travail sont source de créativité et d’exploration de nouvelles opportunités. Elles fonctionnent comme si notre cerveau passait en mode « grand angle », contrairement aux émotions négatives qui nous rabougrissent et favorisent le mode « selfie », le repli sur soi.
2/ Mettre vraiment en œuvre une économie de l’empathie fondée sur la capacité réelle d’écoute. Créer des rituels et des moments au travail où l’on accepte de changer de point de vue, ne serait-ce que momentanément. A titre d’exemple, les chapeaux de Bono constituent un outil intéressant pour s’y exercer en abordant en groupe un sujet sous 6 angles différents (neutralité, émotions, créativité, pessimisme, optimisme, organisation).
Car travailler ensemble, c’est se confronter sans cesse à l’altérité dans un espace de négociations et de compromis intelligents ; c’est poursuivre des objectifs communs tout en prenant en compte les individualités. L’OMS définit ainsi le bien-être au travail : « Un état d’esprit caractérisé par une harmonie satisfaisante entre d’un côté les aptitudes, les besoins et les aspirations du travailleur, et de l’autre les contraintes et les possibilités du milieu de travail. »
3/ Prendre en compte la situation des managers. Garants de la collaboration, ils sont devenus des femmes et hommes-sandwich : coincés entre les dirigeants et l’ensemble des salariés, souvent propulsés à ce rôle en tant qu’anciens experts techniques, ils n’ont pas été formés aux soft skills et se livrent généralement peu sur leurs difficultés. Un cocktail à hauts risques pour eux-mêmes mais aussi pour leurs équipes. Le management toxique, ça vous dit quelque chose ?
Face au mal-être au travail, il n’est jamais trop tard pour agir ni jamais impossible de se relever. Jean-Denis Budin, et tant d’autres, en sont la preuve.
Illustration : un grand merci à Marie Lemaistre et Fllow