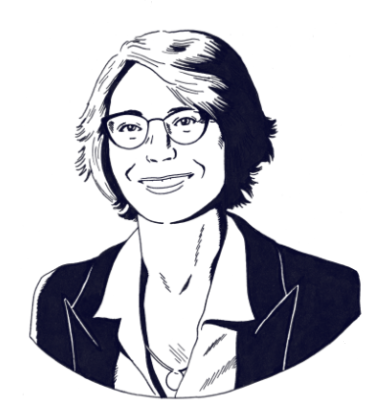Catherine a 55 ans. Depuis dix mois, elle est la copropriétaire et cogérante de Contact fermetures, une PME de 6 millions d’euros de chiffre d’affaires et de 30 salariés, qui vend et pose des portes, fenêtres et volets, dans le Haut-Rhin, près de Colmar. Spécialiste en logistique, elle a lâché une carrière de 23 ans chez Oracle, où elle a gravi les échelons et parcouru le monde pour implanter les solutions de soutien aux clients de ce géant de l’informatique. « J’étais arrivée à un niveau où tout était trop politique, je ne voyais plus mon impact, la réelle valeur de mon travail », confie-t-elle.
Milly a 32 ans, et depuis le 1er janvier dernier, elle est copropriétaire et codirigeante de Someo, une TPE spécialisée dans la distribution de matériel de maintenance pour les canalisations, en Gironde, avec 5 employés et 1,5 million de chiffre d’affaires. Diplômée de la Toulouse Business School, elle a fait ses armes dans la grande distribution, chez Carrefour, avant de quitter l’Ile-de-France et de racheter cette petite boîte : « J’ai toujours voulu être entrepreneure, j’aime manager, mais je ne suis pas une grande aventurière, ni une grande créative », explique-t-elle.
Catherine, Milly : voilà les nouveaux visages de la reprise d’entreprise en France. Des femmes, anciennes salariées, qui ont voulu entreprendre sans passer par la case création. Point commun de Catherine Ventris et Milly Poujol : leur projet de reprise était un projet personnel dans lequel elles ont fini par entraîner leur conjoint. Mais les forces motrices, ce sont elles ! Même si chacune en convient : être à deux, ça aide !
Catherine et Milly se sont d’emblée dirigées vers la reprise d’entreprise. Mais beaucoup de femmes qui veulent se lancer dans l’entrepreneuriat ne pensent pas à cette option … et beaucoup de cédants n’imaginent pas qu’une femme puisse racheter leur activité.
500 000 entreprises à vendre !
La France vieillit. Pas seulement les salariés. Les patrons aussi. Aujourd’hui 1 dirigeant de PME/ETI sur 4 a plus de 60 ans. Et une PME/ETI sur deux est en situation de transmission, selon une étude du Transmission Lab publiée en mars 2024.
Au total, ce ne sont pas moins de 500 000 entreprises qui devraient être cédées en France dans les dix prochaines années. Le ministère chargé du Commerce, de l’Artisanat et des PME a d’ailleurs sonné l’alarme au début de l’été : il a lancé le 8 juillet une mission pour favoriser la reprise d’entreprise et éviter que des savoir-faire ne disparaissent, que des territoires ne se meurent.
Mais qui pour reprendre ces milliers d’entreprises ? Les cédants, en grande majorité des hommes (9 sur 10), n’anticipent pas forcément le temps que prend une transmission. Surtout, ils imaginent que leur successeur sera forcément un entrepreneur, comprenez un homme ayant déjà créé une entreprise.
Ils n’ont pas complètement tort : aujourd’hui, les femmes ne représentent qu’un tiers des reprises-transmissions en France, une part stable depuis dix ans selon le Baromètre sur l’entrepreneuriat féminin publié par Bercy en mars dernier. Soit à peu près la même proportion que parmi les créateurs d’entreprise.
Ce chiffre est beaucoup plus bas si l’on s’en tient aux repreneurs « externes » : ceux qui ne sont ni des héritiers ni des salariés. Seules 5% sont des femmes, assure le réseau Les Premières qui a lancé il y a deux ans un programme d’accompagnement dédié à la reprise d’entreprise, baptisé Switch.
Pourtant, l’envie d’entreprendre n’a jamais été aussi élevée chez les femmes : 59% d’entre elles considèrent que créer son entreprise est plus motivant que le salariat (41%), un chiffre en hausse de 11 points par rapport à 2024, et qui culmine à 63% chez les moins de 35 ans, d’après un sondage OpinionWay pour France Active et la Fédération Bancaire Française, publié en mars dernier.
« Trois freins retiennent les femmes de se lancer dans la reprise d’entreprise, estime Caroline Dumond, déléguée générale chez Les Premières Sud, qui a conçu le programme Switch. Elles n’y pensent pas, elles imaginent que c’est trop cher et qu’elles ne pourront pas intégrer leurs valeurs dans une entreprise qu’elles n’ont pas créée. » Le programme Switch, qui aura accompagné 10 promotions fin 2025 (32 bénéficiaires au total), vise à briser ces freins. Il propose une période intensive de trois mois pour monter en compétence sur les aspects juridiques et financiers, travailler sa posture, établir un plan de prospection, et se poursuit par un accompagnement durant 15 mois pour aider la candidate à la reprise à trouver LA pépite.
20 ou 30 000 euros pour tenter l’aventure
Si la moyenne d’âge des participantes se situe en général dans la quarantaine, les moyens financiers dont elles disposent peuvent être très variables : cela peut aller de 20 000 à 500 000 euros. « L’un des objectifs de la formation est d’apprendre comment on peut augmenter ses fonds propres et mobiliser en complément des prêts bancaires », explique Caroline Dumond. Ainsi, avec une mise de départ à 30 000 euros, rien n’empêche de viser une affaire valorisée 200 000 euros.
Le premier frein à lever est souvent d’ordre financier : les candidates à la reprise s’imaginent qu’il faut beaucoup d’argent. « La très grande majorité des entreprises à reprendre en France (plus de 90%) sont des TPE, comptant de 1 à 9 salariés, plus accessibles financièrement que les PME », souligne Marjolaine Pierrat-Feraille, déléguée générale du réseau Les Premières. Selon l’association, un capital de départ de 30 000 euros peut suffire pour reprendre, par exemple, un fonds de commerce. D’ailleurs, seulement 18% des entrepreneures investissent plus de 40 000 euros dans leur projet.
« Les femmes sont plutôt intéressées par de petites activités, confirme Patrick Behra, fondateur de l’Arca (Association des repreneurs et cédants d’Alsace). Pour reprendre une PME, le ticket minimum est de 50 000 euros et la moyenne plutôt à 100-150 000 euros. »
De fait, il n’existe pas vraiment de figures de référence, de rôles modèles de repreneuses à la tête de PME. Sauf dans le cadre familial, où les femmes représentent 20% des reprises, et où certaines success-stories (Anne-Sophie Pic dans la gastronomie avec la maison éponyme, Stéphanie de Boüard-Rivoal dans les vins avec Château Angélus, etc.) sont régulièrement médiatisées.
Parmi les critères financiers, outre l’enveloppe dont on peut disposer pour acheter une entreprise, il faut aussi être vigilant sur l’état de la société cédée et sur la qualité de son bilan, alerte Nadia Nardonnet, présidente du Transmission Lab : « Toutes les entreprises à céder ne sont pas forcément bonnes à prendre ». Mieux vaut viser une entreprise saine et vérifier que son marché est porteur afin d’éviter les mauvaises surprises… Le travail sur la valorisation de l’entreprise est capital (et pas facile) !
Des mois de recherche
Si le gisement d’entreprises à reprendre est important, « c’est quand même le vendeur qui choisit, remarque Milly Poujol, car les acquéreurs veulent les mêmes entreprises, celles qui marchent ! » Milly et son conjoint ont trouvé en deux mois, un record. Ils s’étaient donné deux ans. Ils ont étudié 15 dossiers en détail et ont visité 5 entreprises. Une fois la lettre d’intention signée avec les fondateurs de Someo, six mois ont suffi pour boucler le rachat. Un calendrier exceptionnellement rapide.
Pour Catherine Ventris, cela a pris beaucoup plus de temps : trois ans, avant de conclure avec Contact Fermetures. « Le rythme du cédant est plus lent que celui des acquéreurs », relève Catherine qui a regardé une vingtaine de dossiers et formulé au moins cinq propositions pour que l’une d’entre elles aboutisse. « Deux cessions sur trois ne vont pas au bout car le cédant n’est pas prêt », prévient Nadia Nardonnet qui recommande de s’assurer que le propriétaire est bien dans une logique de transmission.
D’autres facteurs peuvent ralentir le processus : la zone géographique choisie, le savoir-faire technique de l’entreprise visée. Ecumer les sites spécialisés comme Bpifrance transmission et Fusacq exige une bonne méthodologie.
Endosser le costume de patron, pas si simple !
Et puis, il y a la posture. Plus encore qu’avec le banquier, le face-à-face avec le vendeur est crucial : « Il doit permettre à une entrepreneure d’affronter sans faillir un cédant au profil senior pour le convaincre qu’une jeune femme a le bon profil, les compétences et les « épaules » pour reprendre cette entreprise qu’il a créée, à laquelle il tient comme à la prunelle de ses yeux », détaille Marjolaine Pierrat-Feraille chez Les Premières.
Du haut de ses 32 ans, Milly Poujol joue l’effet de surprise. Et ça marche ! « En étant juste soi-même, on capte l’attention, dit-elle. Même si elle est négative, on peut en faire quelque chose ! » De son côté, Catherine Ventris reconnaît que, sans son mari fort d’une expérience dans le secteur automobile, elle aurait plutôt racheté une entreprise de services.
Toutes les deux s’accordent sur les avantages de la reprise : il y a déjà un actif, des clients, un carnet de commandes, du stock, etc. Et la possibilité de se verser un salaire assez rapidement. Même si selon Patrick Behra, il vaut mieux attendre un an avant de se payer, pour ne pas mettre l’entreprise en péril. Ce spécialiste de la reprise alerte aussi sur la nécessité absolue de se faire accompagner, par des experts (comptables, juristes) et des réseaux comme Arca, Réseau Entreprendre, le CRA, etc. Car si la reprise paraît plus sûre que la création, « des épiphénomènes peuvent compliquer la situation », dit-il. Il met en garde contre plusieurs risques : le choc des cultures (entre la grande entreprise dont est issue la repreneuse et le monde de l’artisanat) ; la difficulté à prendre la place de patron ; l’isolement du dirigeant ; le départ brutal d’un salarié clé qui espérait reprendre l’activité, etc.
Se former est indispensable. C’est ce qu’ont fait Milly et Catherine. Cela n’empêche pas les découvertes sur le terrain, une fois les clés de la boite entre les mains : « J’ai passé un maximum de temps avec les salariés, les clients, pour comprendre les métiers et les produits », raconte Milly. Catherine a réalisé que l’entreprise n’était pas structurée, que les précédents patrons faisaient tout eux-mêmes, travaillant de 6h à 19h tous les jours ! « On est au four et au moulin » souffle-t-elle, avec l’ambition désormais de responsabiliser davantage les ouvriers et d’engager un projet d’informatisation.
Ni l’une ni l’autre ne regrette son choix. Mais « devenir entrepreneure, ça impacte toute la vie », prévient Milly Poujol. « Il faut être costaud, faire face à tout, tout le temps », complète Catherine Ventris. Alors si l’aventure vous tente, profitez de l’événement BIG 2025 organisé par Bpifrance pour suivre le parcours thématique transmission : un bon moyen de se familiariser avec les arcanes de la reprise d’entreprise !