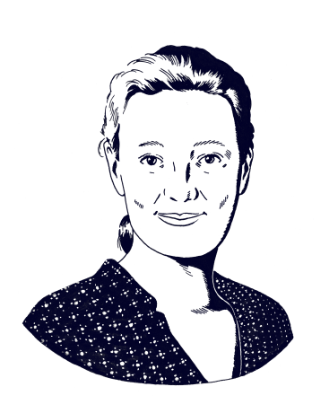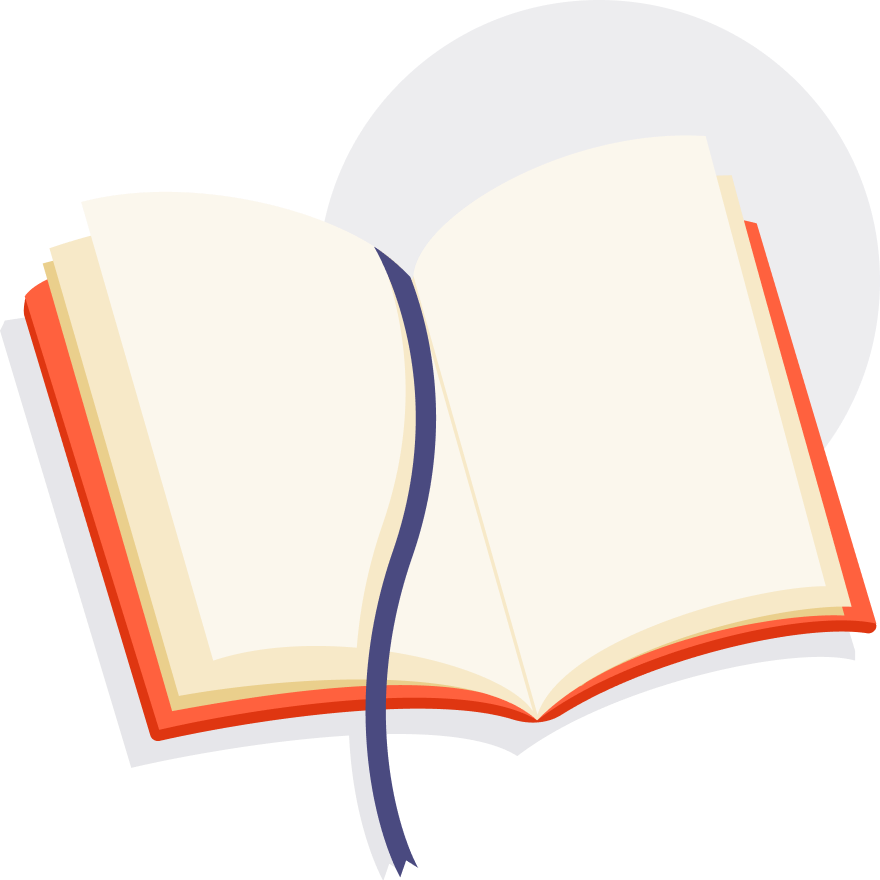C’est vrai que la définition historique convoque une vision d’un autre temps puisque le patriarcat désignait un système dans lequel l’autorité et les droits sur les biens et les personnes étaient détenus par un homme d’âge mûr régnant en maître sur sa communauté. Il faut bien reconnaître que la société française moderne a sensiblement évolué.
Un rapport choc de la Fondation des femmes
Mais le terme a été revisité dans les années 1970 par la deuxième vague féministe pour dénoncer un système social et économique plus large d’oppression des femmes. Avec cette définition-là, le mot conserve hélas une certaine pertinence : il est indéniable que les femmes ont encore et toujours moins d’argent et de pouvoir que les hommes.
Le 2 février, la Fondation des femmes, avec son Observatoire de l’émancipation économique des femmes, a publié un rapport au titre choc, « La dépendance économique, une affaire d’Etat ? Comment le patriarcat économique de l’Etat dépossède les femmes de leur indépendance économique », qui remet le patriarcat sous le feu des projecteurs.
Comment et pourquoi notre État serait-il le « suppôt » du patriarcat ? Eh bien, notre État a beau parfois promouvoir l’égalité femmes-hommes, il n’en demeure pas moins que parmi l’ensemble des politiques fiscales et sociales développées depuis plus d’un siècle -dont beaucoup n’ont pas été abolies- il reste une bonne dose de patriarcat. Certaines politiques sont le reflet de la société qui les a vues naître. D’autres sont le produit des boys clubs de l’histoire, soucieux de préserver leurs privilèges économiques et d’inciter les femmes à rester à leur place (au foyer).
Non seulement ces politiques n’ont pas disparu mais, en plus, les éléments les plus redistributifs du système -visant à protéger les femmes des effets d’une société patriarcale- se sont considérablement affaiblis. Parmi ces derniers, il y a la pension de réversion (censée protéger la veuve qui a mis sa carrière en retrait pour s’occuper de son foyer), les pensions alimentaires (censées empêcher les hommes de négliger leurs responsabilités paternelles), et de nombreuses prestations sociales…
Aujourd’hui, nos politiques se basent encore sur une vision obsolète du foyer dans lequel la “solidarité conjugale” est prise pour acquise et où les femmes sont toujours sous la tutelle de leur conjoint. Qu’il s’agisse de notre fiscalité, de notre système de retraite, du versement de nos prestations sociales, il est grand temps d’en finir avec le patriarcat d’État. Cela ne relève même pas du féminisme radical, juste du bon sens. Illustration en trois points.
Votre conjoint peut payer, non ?
En 2021, une campagne contre la « conjugalisation » de l’allocation adulte handicapé fait rage. L’AAH, une prestation versée aux personnes dont le handicap rend difficile l’accès au marché du travail, est inférieure à 1000 euros. Mais elle est conditionnée aux revenus d’un éventuel conjoint. Pour les militantes qui se sont emparées du sujet, le fait de conjugaliser cette prestation crée des situations de dépendance économique et accroît le risque de violences conjugales. Célibataires, vous touchez votre prestation mais dès que vous êtes en couple, vous êtes censée être entretenue intégralement par votre conjoint, ce qu’il ne s’empêchera pas de vous rappeler régulièrement, parfois avec des coups, expliquent les militantes. Victoire : en 2022, on a voté un amendement prévoyant la déconjugalisation de l’AAH.
Ce qui est vrai de l’AAH l’est aussi de la plupart des prestations sociales, comme la prime d’activité, censée encourager le travail individuel, l’aide personnalisée au logement, le revenu de solidarité active ou encore l’assurance vieillesse du parent au foyer, que vous perdez sitôt que vous êtes en concubinage. La conditionnalité de prestations censées assurer une indépendance financière à des personnes précaires les met sous la tutelle d’un conjoint, dont on suppose naturellement qu’il entretiendra sa compagne. Cela crée une relation de dépendance et un terreau favorable aux violences conjugales. Il ne serait pas compliqué de supprimer la conjugalisation de toutes les prestations sociales à l’image de ce que l’on a fait avec l’AAH. En plus, cela permettrait aux personnes concernées de vivre leur vie amoureuse plus librement (sans avoir à cacher leur situation de concubinage).
Le travail gratuit ne paye vraiment pas
La Palice en aurait dit autant, n’est-ce pas ? Pourtant, depuis la Révolution industrielle et la séparation de la production (masculine) dans les usines et de la reproduction (féminine) de la force de travail à domicile, le salaire était censé concerner les deux. Donc le travail gratuit était quand même payant puisque le salaire de l’ouvrier devait en théorie couvrir le travail à l’usine, le ménage domestique et la soupe des marmots. C’est pour cela qu’on a imaginé la pension de réversion : si une femme interrompt sa carrière pour élever des enfants et soutenir son époux, elle doit pouvoir toucher une partie de la pension de retraite de ce dernier quand elle devient veuve. C’est le deal : elle se sacrifie financièrement pour la famille mais en échange, on estime que son travail gratuit lui vaut des protections financières.
Hélas depuis que les femmes sont entrées massivement dans le monde du travail payé, le deal est moins clair. Elles continuent de faire plus de travail gratuit. Mais on estime à tort qu’elles ont moins besoin d’être protégées. Elles occupent des emplois moins payés (dans les métiers du care). Elles travaillent davantage à temps partiel (avec des salaires partiels). Elles s’interrompent davantage pour s’occuper des enfants et des personnes âgées ou handicapées dépendantes. Résultat : non seulement les femmes gagnent moins et accumulent moins de capital, mais à la retraite, leurs pensions (de droit direct) sont inférieures de 40% à celles de leurs homologues masculins !
Grâce aux pensions de réversion, cet écart tombe à 28%. Mais la pension de réversion ne concerne que les personnes mariées alors que les mêmes “choix” sont faits au sein des couples non mariés, aujourd’hui beaucoup plus nombreux. En d’autres termes, les protections tendent à s’affaiblir. Le travail gratuit paye de moins en moins. Étendre la pension de réversion aux couples non mariés paraît indispensable. Mais il faudrait aussi que les femmes élevant des enfants sans jamais avoir été en couple ne soient pas laissées pour compte non plus. Enfin, il semble aberrant que l’on demande aux femmes qui ont assumé tant de travail gratuit au cours de leur vie, de cotiser encore plus longtemps pour espérer obtenir une retraite décente.
Ce cadeau fiscal qu’on ne peut plus se permettre
La France est, avec l’Allemagne, championne du patriarcat fiscal en Europe grâce au quotient conjugal de l’impôt sur le revenu (voir notre newsletter passée sur le sujet). Là où les revenus du foyer sont inégalitaires, la conjugalisation de l’impôt favorise la personne qui gagne le plus. En effet, quelqu’un qui gagne bien sa vie, en couple avec une personne à petit revenu, voit son taux diminué. Inversement, le “pauvre” du couple (dans 75% des cas, la femme) voit ses revenus taxés davantage qu’ils ne le seraient en l’absence de quotient conjugal.
Cela représente, comme l’explique le rapport de la Fondation des femmes, « un cadeau fiscal fait aux hommes aisés ». Sous le régime de la conjugalité, le taux d’imposition sur le revenu des hommes baisse de 13 points en moyenne grâce aux revenus bas de leur conjointe, tandis que celui des femmes augmente de 6 points en moyenne. De plus, le système freine le retour à l’emploi de ces femmes qui ont quitté le monde du travail. Ce cadeau fiscal qui favorise majoritairement les hommes et les foyers les plus aisés coûterait entre 11 et 27,7 milliards à l’État. Le supprimer permettrait sans doute de financer la déconjugalisation des prestations sociales !
Pleines d’incohérences et d’anachronismes, nos politiques fiscales et sociales continuent de mettre les femmes sous la tutelle des hommes et de freiner leur indépendance financière. Le patriarcat d’État dénoncé par le rapport de la Fondation des femmes n’est pas un système machiavélique parfait. C’est un bric-à-brac de vieilles mesures jamais remises au goût du jour, de cadeaux fiscaux protégés jalousement par ceux qui en profitent et de mécanismes de protection que l’on laisse s’affaiblir. Une série de réformes de bon sens s’imposent pour moderniser le système afin qu’il favorise l’égalité.