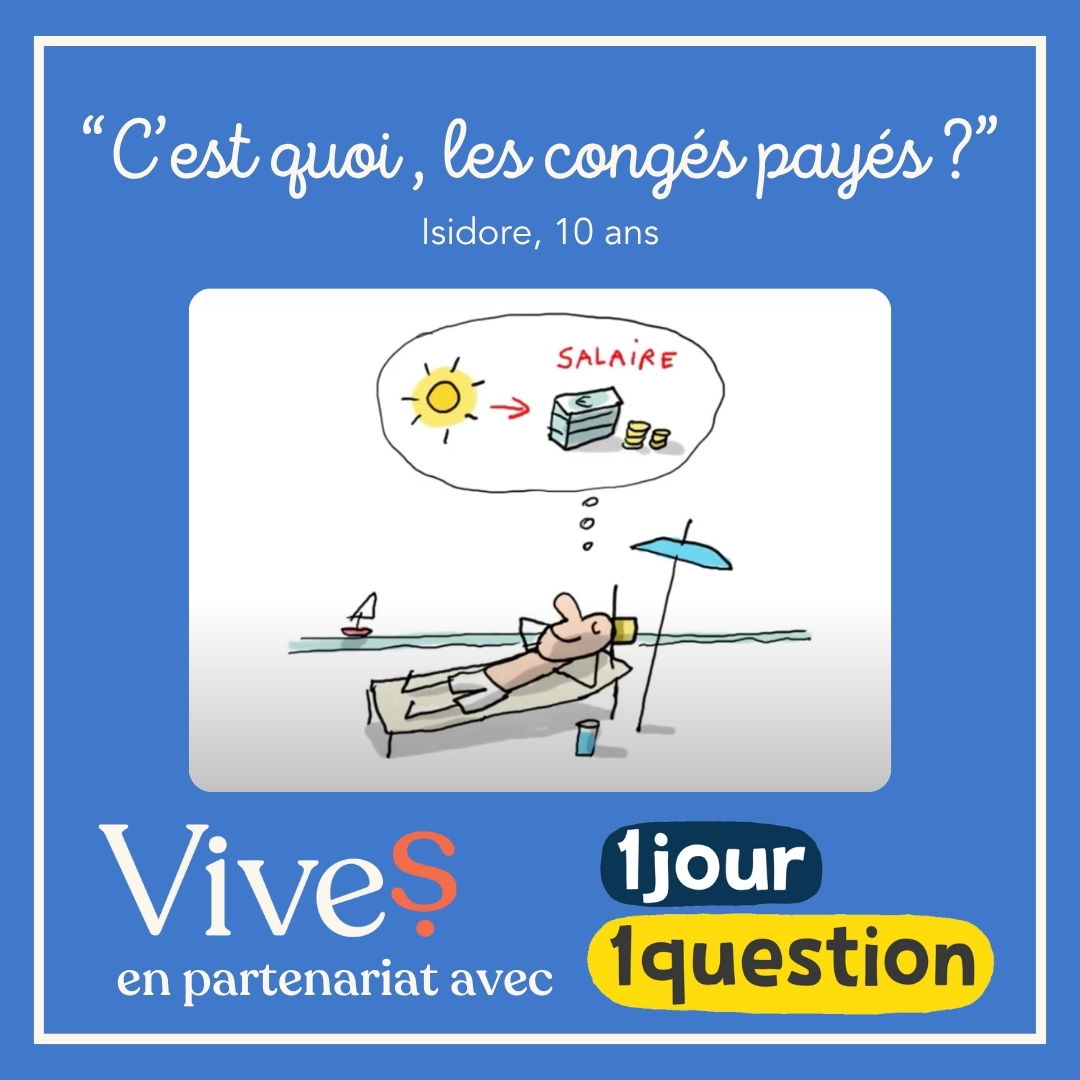Je ne me souviens pas de mon grand-père en vacances. Comme beaucoup de ses contemporains dans les années 30, il ne s’arrêtait de travailler que le dimanche et certains jours fériés.
Les vacances d’été étaient réservées aux plus riches bourgeois, et à certains fonctionnaires qui avaient, depuis les années 1850, droit à 15 jours de congés payés. Cela a d’ailleurs coïncidé avec le développement des premières stations balnéaires normandes comme Cabourg ou Houlgate.
Loin de la fraîcheur normande, les travailleurs poursuivaient leur labeur, mais le débat agitait déjà les politiques et syndicats depuis les années 20, pour demander un temps de repos rémunéré pour tous, dans un esprit d’équité. Il faudra pourtant attendre 1936 et l’arrivée du Front populaire au pouvoir, pour l’obtention de 15 jours par an (dont 12 jours ouvrables). Aussitôt, la population s’en saisit, les plus chanceux pour aller au vert, les autres pour aider leurs proches aux champs.
Petit à petit, la durée des congés payés s’est allongée, le temps de travail raccourci, comme l’explique cette petite vidéo d’1 Jour 1 Question, racontée à hauteur d’enfant. Il est bon de se souvenir nous-mêmes et de parler avec nos jeunes de ce droit acquis, souvent discuté, mais qui reste une grande chance. Celle de se reposer sans perdre son gagne-pain, de recharger ses batteries, et d’accorder de la place à sa vie personnelle au sein d’une vie encore dominée par le travail.
👀 Regarder la vidéo |
Illustration : Jacques Azam- 1 jour 1 question