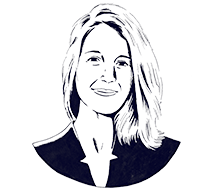Je n’ai que 41 ans… et pourtant, depuis mon doctorat en sociologie soutenu il y a plus de dix ans, j’ai toujours cherché à comprendre comment vivent les retraités. Surtout les femmes. Car il est une évidence : nous serons toutes vieilles un jour ! Je l’ai compris en observant ma grand-mère maternelle. Issue des classes populaires, elle me semblait vivre dignement sa retraite. Mais chez elle, un sou était un sou, il était préférable de réparer ses vêtements plutôt que d’en acheter, aller chez le dentiste était coûteux, et ses vacances étaient en partie financées par ma mère. Bien évidemment, elle m’a aussi appris à être fière des premiers signes de l’âge. Au-delà de son histoire, j’ai ensuite amassé des analyses sur l’importance de garder ou non ses cheveux blancs, sur le besoin d’équilibre entre se sentir utile et se faire plaisir, etc.
Autant d’éléments qui me permettent d’esquisser la retraitée que je désire être demain. Aussi, lorsque ViveS et la Fondation des Femmes m’ont proposé de travailler avec Elsa Foucraut sur le « coût d’être retraitée », j’y ai vu une forme de nécessité. Nécessité de mettre en lumière le vécu de nombreuses femmes que je rencontre dans mes recherches, de comprendre les inégalités de genre à la retraite, et de proposer des pistes pour améliorer le sort de celles qui, demain, seront à leur tour retraitées. La note publiée aujourd’hui par l’Observatoire de l’émancipation économique des femmes de la Fondation des Femmes, en partenariat avec ViveS Média, révèle à quel point ce sujet reste un angle mort des politiques publiques.
Plus de 4 millions de retraitées pauvres
Quelle est la situation financière des femmes retraitées ?Aujourd’hui, les hommes perçoivent une pension de retraite 62 % supérieure à celle des femmes et partent à la retraite plus tôt que les femmes. En moyenne, les femmes liquident leurs droits à la retraite huit mois après les hommes… La pauvreté chez les personnes âgées reste fortement genrée. Parmi les retraités percevant une pension inférieure ou égale à 1 000 euros par mois, un tiers (soit environ 5,7 millions de personnes) sont concernés, et parmi eux, près de 75 % sont des femmes. Ce qui représente près de 4,3 millions de femmes.
La retraite agit comme un miroir grossissant de l’ensemble du parcours de vie. Le système d’assurance retraite ne se contente pas de reproduire les inégalités accumulées tout au long de la vie, il a tendance à les amplifier.
Monoparentalité, divorce, aidance : des phénomènes ignorés
En parcourant diverses études et rapports, j’ai été rapidement saisie par ce lien évident entre marché du travail et retraite. Mais alors, pourquoi les réformes ne prennent-elles jamais en compte ces deux dimensions de façon conjointe ? Certes, le système de retraite a intégré certaines situations comme la maternité ou le veuvage, mais toujours selon une logique familialiste et patriarcale, c’est‑à‑dire en considérant les femmes avant tout comme épouses et mères plutôt que comme actrices à part entière du monde du travail.
En 1945, lors de la création de la Sécurité sociale, ce modèle se construit autour de la famille nucléaire, où l’homme occupe la place de principal pourvoyeur de ressources. Il cotise pour accéder à des droits propres en matière de couverture sociale. Les femmes, quant à elles, sont tenues au rôle de gestion du foyer et de l’éducation des enfants. Même lorsqu’elles exercent une activité professionnelle, leurs droits à la retraite demeurent limités. Elles n’accèdent ainsi que de façon marginale à des droits directs et dépendent surtout de droits dérivés, au titre d’épouse, via la pension de réversion.
Ce cadre reste aveugle aux réalités actuelles et futures, telles que la monoparentalité, l’aidance ou les divorces. L’un des enseignements majeurs de cette note est clair : le système de retraite devrait être repensé en articulation avec le marché de l’emploi et adapté à la diversité des parcours de vie des femmes. Sans cela, il ne fait que creuser des inégalités qui se cumulent tout au long de la vie personnelle et professionnelle des femmes.
Ces inégalités économiques pèsent lourdement sur le quotidien des retraitées les moins bien loties. Elles doivent renoncer à des dépenses spécifiques : chauffer leur logement lorsqu’il fait froid, inviter des proches à leur domicile, etc. Elles doivent faire des arbitrages entre se nourrir, se soigner et se chauffer. Ce constat est sans appel : 69 % des personnes âgées en situation de pauvreté connaissent des privations pour des raisons financières.
L'oubli du genre
Dès lors une question essentielle s’impose : pourquoi le genre n’est-il pas réellement pris en compte ? Il a fallu attendre les années 2010 pour qu’une réforme des retraites inscrive dans la loi le principe d’égalité entre les femmes et les hommes et fixe un objectif de réduction de l’écart de pension entre les femmes et les hommes.
Or, la réforme de 2023 a bien montré qu’il ne s’agissait que d’un principe et pas d’une véritable logique d’action. En effet, lors de cette réforme, les décideurs politiques ont fait le choix de porter l’âge légal de la retraite à 64 ans, malgré les répercussions négatives de cette mesure sur l’emploi des femmes et sur leur âge de départ.
Quant aux pensions de réversion, instaurées en 1945, elles ont certes largement contribué à réduire les inégalités entre les femmes et les hommes à la retraite. Toutefois, elles ne concernent que les femmes mariées et relèvent de droits dérivés, et non de droits propres. La conquête d’une pension de retraite autonome et décente constitue, pour les femmes, une bataille qui n’est pas encore terminée.
Une contribution sous-estimée au travail gratuit
Au-delà des niveaux de pension, la retraite marque un profond changement dans la manière dont le temps est vécu et perçu. Le travail, qui structurait l’emploi du temps, laisse place à d’autres activités sociales et de loisirs, de temps pour soi, et parfois à de nouvelles obligations familiales (grand-maternité, aidance). La retraite est ainsi une période propice à la redéfinition de ses priorités et de ses aspirations, tout en exigeant de jongler avec ces multiples sollicitations. Les femmes retraitées contribuent à une richesse économique et sociale que ce soit dans les associations, dans la vie familiale ou même dans les tâches domestiques. Pourtant, cette contribution demeure largement sous‑estimée et peine encore à être reconnue.
L’absence de données, une autre forme d’invisibilisation
Pour mieux agir, il faut notamment compter, dénombrer. Or, ce qui est le plus frappant, c’est le manque de données qui croisent à la fois le genre et l’âge, voire les bornes d’âge dans de nombreuses statistiques publiques.
Quelques exemples : les statistiques sur les violences faites aux femme dans l’espace public s’arrêtent à 69 ans ; le frottis cervico-utérin n’est plus systématique, ni recommandé au-delà de 65 ans ; l’étude Cadre de vie et sécurité du ministère de l’Intérieur sur les violences physiques et sexuelles au sein du couple exclut les femmes de plus de 75 ans (alors que l’espérance de vie moyenne des femmes en France est de 86 ans); les différences genrées entre grands-parents dans le soin aux petits-enfants restent sous-documentées…
Les conséquences sont terribles : invisibilisation, vide en matière de politiques publiques et de connaissance sur certains sujets liés à la santé, aux violences faites aux femmes ou à leurs modes de vie, marginalisation dans les priorités d’actions, et sous-diagnostics persistants.
10 recommandations
En conclusion de la note, rédigée avec Elsa Foucraut, nous avons formulé dix recommandations pour réduire le coût d’être retraitée et améliorer concrètement les conditions de vie.
Parmi celles-ci, cinq me semblent particulièrement décisives :
- Adosser à toute future réforme des retraites une réforme ambitieuse en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes.
- Rehausser le minimum vieillesse pour lutter contre l’indignité et la pauvreté des femmes âgées.
- Ne pas reculer l’âge de départ en retraite.
- Inclure la variable genre dans les enquêtes statistiques sur les modes de vie des retraité.e.s, et la variable âge dans les enquêtes sur les inégalités domestiques.
- Comptabiliser les violences faites aux femmes quel que soit leur âge.
Il est donc indéniable qu’une bataille féministe est à mener pour que nous puissions toutes vivre dignement à la retraite.