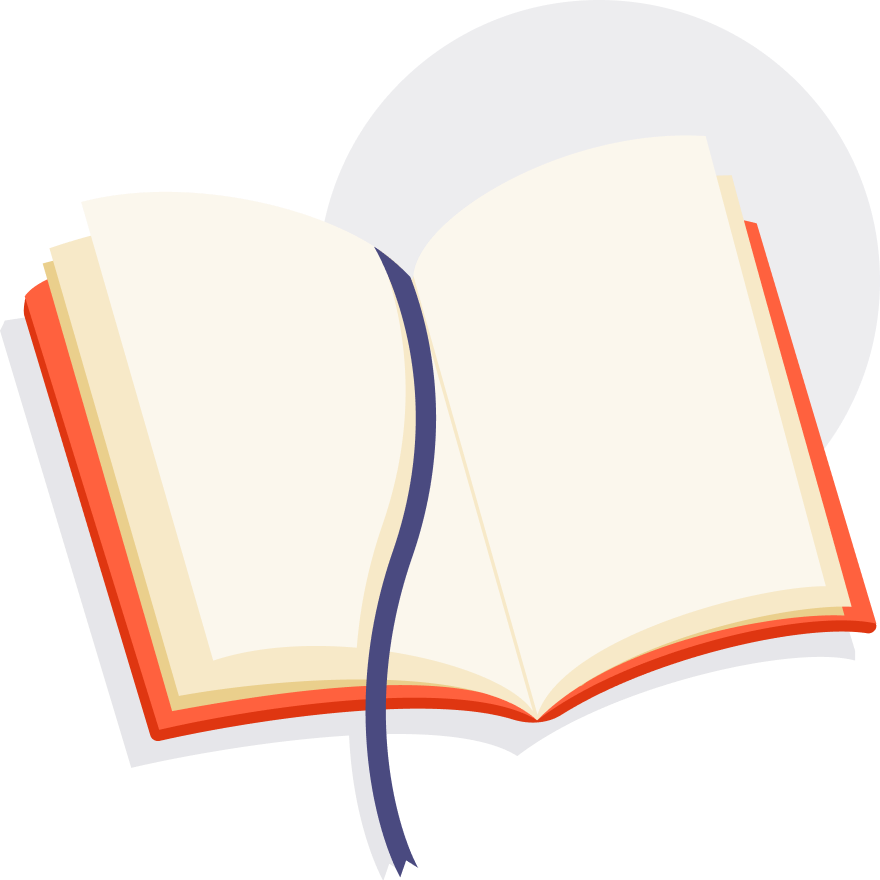« Pas de compte, pas d’argent, pas de patrimoine… je n’avais rien à moi »
Nous voilà parties dans une discussion passionnée (et passionnante) sur les ressorts de ces violences économiques, auxquelles ViveS avait consacré une première newsletter en janvier dernier. Quand soudain, la jeune femme assise à la table d’à côté se penche vers nous. Elle a un visage doux et grave. Elle s’excuse de nous interrompre, dit avoir entendu notre conversation, s’excuse encore de son impolitesse et nous lâche calmement : « Tout ce que vous évoquez, je l’ai vécu. Depuis mes 20 ans, j’étais sous emprise de mon mari entrepreneur, j’ai voulu le quitter, je me suis rendu compte que je n’avais rien à moi. Pas de compte, pas d’argent, pas de patrimoine. Quand je suis allée au service des impôts, l’agent qui m’a reçue a soupiré : “des femmes comme vous, j’en vois tous les jours, monsieur met tout dans des SCI, sans la signature de madame, et le jour de la séparation, pschitt, tout disparaît !” Heureusement j’étais salariée de son entreprise, j’ai au moins perçu le chômage. Mais j’étais à la rue, j’ai dû être hébergée chez des amis, il m’a collé procès sur procès, mon argent a filé dans les frais d’avocats, il a ligué mes aînés contre moi, seul le plus petit est resté avec moi, et je me bats encore pour faire reconnaître mes droits. J’ai été trop bête, je n’étais pas informée, pas éduquée, aujourd’hui je me rattrape, je lis beaucoup, j’essaie de comprendre… »
Elle nous a parlé d’une traite, et nous sommes restées saisies. Par son histoire, par son courage et par l’immense sentiment de culpabilité qu’elle portait. Comme si tout était de sa faute. Elle était si digne et pourtant, tant de souffrance émanait de ses propos.
Alors que le 25 novembre marque la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, pour elle, et pour toutes celles qui n’osent pas parler, nous avons le devoir de raconter. D’expliquer ce que sont les violences économiques, encore trop méconnues. Elles surviennent souvent dans le cas d’une séparation : « Trois-quart des mères séparées sont exposées aux violences économiques, rappelle la sociologue Emilie Biland-Curinier. Et la première de ces violences, c’est le non-paiement de la pension alimentaire ». Mais pas seulement. Un conjoint qui vous empêche de travailler, qui veut contrôler vos dépenses, qui refuse de partager équitablement le budget du foyer, qui capte les aides sociales à son seul profit ou qui souscrit un crédit sans vous le dire se rend aussi coupable de violences économiques.
Le risque existe dans tous les milieux
D’après un sondage réalisé par l’IFOP pour la newsletter Les Glorieuses publié fin octobre, 41% des femmes ayant vécu en couple ont déjà subi au moins une forme de violence économique conjugale. Une femme sur 3 ayant été victime de violences économiques a subi par la suite une autre forme de violences conjugales. Pire, plus de deux femmes sur trois ayant été victimes de violence économique ont subi en même temps une autre forme de violences conjugales. Quand la Fédération Nationale Solidarité Femmes a diffusé l’an dernier son clip pour alerter sur les violences économiques, mettant en scène une fausse application, Eye money, supposée offrir la possibilité aux hommes de contrôler financièrement leurs femmes, certains ont cherché à savoir où ils pouvaient la télécharger ! Incroyable, mais vrai…
Le risque existe dans tous les milieux, mais selon le sondage de l’IFOP, une femme a deux fois plus de chance d’être victime de violences économiques si elle gagne beaucoup moins que son conjoint. C’est ce qui est arrivé à Véronique*, la cinquantaine aujourd’hui. Elle se marie à 22 ans, alors qu’elle est encore étudiante. Elle commence à travailler comme enseignante, mais s’arrête à l’arrivée du deuxième enfant. « Il faut s’occuper de la famille », glisse le papa. « J’ai eu un doute, avoue Véronique, mais j’ai vu la facilité. Nous avons eu trois enfants à 18 mois d’écart puis le dernier deux ans après. Mon mari était entrepreneur, il avait beaucoup de déplacements. Autour de moi, très peu de femmes travaillaient. Et puis, j’ai aimé m’occuper de mes enfants, j’étais impliquée à l’école, dans les activités sportives, je faisais de l’aide aux devoirs. J’accompagnais aussi mon mari en voyage professionnel, je recevais les clients. J’étais très prise ! Monsieur finançait tout, il était très large, mais tout était payé par l’entreprise : la voiture, le téléphone, la femme de ménage, etc. Je n’avais rien à mon nom, sauf notre résidence principale qui était à nos deux noms. Il pouvait surveiller toutes mes dépenses. »
« J’étais dépossédée, je n’existais pas comme personne »
Une situation qui ne gêne pas spécialement Véronique. Un jour, tout bascule, quand le petit dernier est victime d’une agression. « Je voulais porter plainte, pas mon mari. Nous habitions dans une petite ville, tout le monde se connaissait et nous connaissions l’agresseur. Je n’ai pas cédé. Pour lui, c’était une déclaration de guerre : il m’a pris la carte bancaire, m’a supprimé les chéquiers, il me donnait seulement du liquide pour les courses quotidiennes, pour le reste il me demandait d’envoyer les factures de mes dépenses au siège de son entreprise. J’en ai été réduite à m’ouvrir un compte en cachette, dans une autre localité, une autre banque, et à me faire des virements en douce depuis le compte commun… jusqu’à ce qu’il le découvre. Il a vidé le compte joint. J’étais dépossédée, tout était au nom du couple, je n’existais pas comme personne. » Véronique s’accroche. Elle cherche un emploi, décroche un temps partiel dans un CFA. Elle gagne tout juste 500 euros par mois. Son mari la dénigre – « c’est du bénévolat », « c’est à peine le montant de la prime de participation de mes salariés ».
Il finit par demander le divorce, elle quitte le domicile conjugal, sa ville, obtient très vite des remplacements en tant que professeure. Car il faut payer les frais d’avocats – six ans de procédures, des dizaines de milliers d’euros engagés. « Le travail m’a permis de me reconstruire, de me prouver que j’étais capable de faire quelque chose ». Elle trouve un poste à temps plein dans un collège, passe les concours, obtient sa titularisation.
« Quand on est marié avec un homme qui a de l’argent, on pense qu’on est à l’aise, en fait c’est notre dépendance qui s’organise. Pendant le procès, il disait que je dépensais trop, j’achetais des marques, mais ça allait avec la fonction, le milieu social ! J’ai fini par gagner la procédure. Quand le montant de la prestation compensatoire a été fixé, il a crâné en disant “pour moi, c’est un mois de bénéfices !” ».
Aujourd’hui, avec un salaire de 2000 euros par mois, Véronique se sent plus libre que dans sa prison dorée d’épouse de notable local. Sa grande victoire, c’est de vivre maintenant de façon totalement indépendante. Mais elle n’a pas travaillé pendant vingt ans : « Il me manque 160 trimestres, donc je n’ai pas de retraite », souffle-t-elle.
Elle travaille, il dépense
Pour aider les femmes à repérer les violences économiques, Les Glorieuses ont mis en ligne un test sur leur plate-forme consacrée au sujet, sur le modèle du violentomètre établi par le Centre Hubertine Auclert. Il s’agit de 25 questions à se poser pour savoir si on est en risque ou pas d’un point de vue économique. Il y a aussi des réflexes simples à adopter, quand on vit en couple, même si on s’aime très fort (ça n’a rien à voir) :
- garder un compte personnel
- ne pas transmettre ses codes d’accès de compte et de carte bancaire
- alimenter le compte joint à proportion de ses revenus quand les deux membres du couple travaillent.
Car la violence économique peut prendre des formes très différentes, y compris la spoliation des ressources de la femme. Jessica a connu son mari à 13 ans. Il en a alors 17. Pendant six mois, il fait le siège de la jeune fille – « il campait en bas de chez moi, je pensais qu’il me faisait la cour mais c’était déjà du harcèlement » dit-elle aujourd’hui. Elle finit par tomber dans ses bras, et plonger dans une relation toxique. Il boit, il fume, ne travaille pas… Pendant ce temps, Jessica va au lycée la semaine ; le week-end elle fait les marchés pour s’offrir une paire de baskets ou une sortie au cinéma. Mais bientôt, c’est elle qui lui achète des baskets, paie ses consommations, ses sorties. Il dépense, elle travaille, s’isole, ment à ses parents pour le couvrir. « Dès que je ne lui donnais pas d’argent, il me traitait d’égoïste, de petite bourgeoise ». Elle réussit à passer le bac et se lance immédiatement après dans une alternance dans un groupe bancaire.
« J’étais autonome et fière de l’être »
« C’est moi qui l’entretenais, en me pensant féministe, raconte Jessica. J’étais autonome financièrement et fière de l’être. Quand je suis tombée enceinte, j’ai dû être alitée. Et là j’ai découvert qu’il avait contracté près de 90 000 euros de dettes à mon nom, des crédits en ligne essentiellement, en usurpant mon identité, ma signature. Chaque matin, des huissiers débarquaient chez nous. J’ai dû appeler le service des ressources humaines de mon entreprise pour dire que mon salaire allait y passer, je n’avais plus d’argent pour me nourrir, j’allais faire la queue au CCAS de ma commune pour récupérer des bons alimentaires. J’ai monté en catastrophe un dossier de surendettement, il y en avait pour 110 000 euros au total, y compris auprès de la banque qui était mon employeur ! »
Jessica rembourse l’intégralité des dettes, elle ne mange qu’une fois par jour, ses parents paient la crèche de la petite. Parce que son mari a volé des chéquiers de son employeur, elle doit accepter une mutation, repartir de zéro dans sa carrière, elle qui avait grimpé les échelons depuis son alternance. Elle veut se séparer, mais il refuse. Les violences économiques ne sont qu’un pan de la violence qu’elle subit : agressions verbales, physiques, psychologiques, viol. Quand les coups portés contre elle commencent à menacer sa fille, c’est le déclic : la jeune mère s’enfuit. Mais le père obtient un droit de visite, puis de garde. Il ne verse aucune pension alimentaire : « Il avait organisé son insolvabilité, il était insaisissable », explique Jessica.
Ardoise : 25 000 euros d’arriérés de pension alimentaire et 70 000 euros de frais d’avocats. Sans compter le coût des soins pour se reconstruire, elle et sa fille. Elle met un mouchoir sur ces pertes financières, tellement elle est occupée à panser ses plaies, physiques et psychologiques.
Remettre la victime au centre
« J’avais un bon job, j’ai été responsable d’agence bancaire, conseillère clientèle haute gamme. J’ai même été sollicitée par des collègues pour répondre à des situations difficiles : le père qui vient vider le livret A de sa fille, mineure, avec la gamine terrorisée à ses côtés ; ou la femme qui débarque juste avant la fermeture, un cocard sur le visage, demander combien il y a sur le compte des enfants… » Jessica s’engage dans une association pour accompagner les femmes victimes de violences. Elle commence à se former… jusqu’à en faire son nouveau métier. Elle est désormais consultante et prône la création d’équipes pluri-disciplinaires autour de chaque victime : assistante sociale, DRH, avocat, banquier, agent immobilier, psychologue spécialisé en traumatisme etc. « Il faut remettre la victime au centre et vulgariser les conseils apportés par les experts pour qu’elle puisse prendre ses décisions en toute conscience » plaide Jessica.
Le rôle des banquiers : détecter, alerter, éduquer
Elle insiste aussi sur le rôle du banquier dans l’identification des violences économiques, et dans le décaissement des fonds, indispensables pour quitter un conjoint violent.
Chez BNP Paribas, première banque à s’être intéressée au sujet en France dès 2022 avec le projet de Paola Vieira pour protéger les clients contre les violences économiques conjugales chez BNP Paribas Personal Finance, une vidéo va être largement diffusée en interne début 2024 pour sensibiliser les collaborateurs et notamment les conseillers. « L’objectif est de les aider à mieux détecter et réagir face aux situations d’urgence en s’appuyant notamment sur des associations partenaires telles que Crésus et l’ADIE », précise-t-on en interne.
L’ensemble du groupe est désormais mobilisé avec toutes les filiales concernées, notamment la banque de détail. « La prévention passe aussi par l’éducation financière et budgétaire des clients, explique Paola Vieira. C’est notre rôle, tout comme l’information des clients sur leurs droits et obligations. Ainsi, si votre conjoint a usurpé votre identité pour contracter un crédit à la consommation, c’est un délit. »
Banques, associations, leaders d’opinion, la mobilisation grandit. Mais le vrai levier de changement serait d’intégrer la notion de violence économique dans le droit pénal, comme le prévoit la Convention d’Istanbul ratifiée par la France en 2014 et comme l’ont déjà fait la Grande-Bretagne et l’Espagne. Un chantier dont seuls les politiques peuvent se saisir…
*Le prénom a été modifié